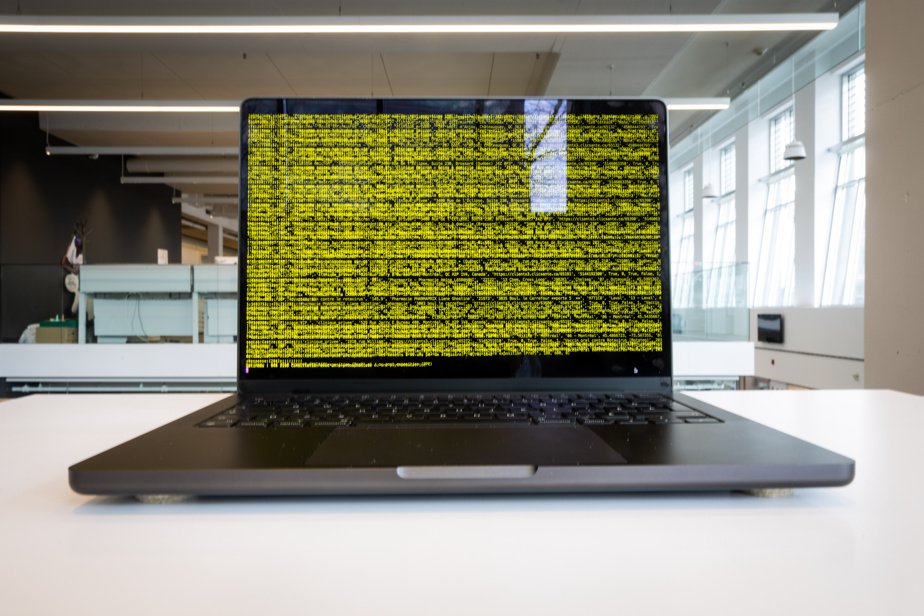La donnée peut-elle aller au-delà de son rôle de ressource économique ? Pourrait-elle avoir désormais la même importance que le dollar a pu avoir au cours des siècles passés ?
Hypothèse fascinante que celle de considérer la donnée non seulement comme un levier de valeur, mais aussi comme une véritable monnaie dans l’économie numérique. Tout comme le billet vert aura façonné des sociétés entières, la manière dont nous gérons les données aujourd’hui pourrait bien définir l’équilibre de nos économies et nos fiscalités de demain. À ses débuts, le dollar n’était qu’un outil parmi tant d’autres, conçu pour stabiliser l’économie naissante des États-Unis. Puis il a évolué, passant d’une monnaie adossée à des métaux précieux comme l’or, à une monnaie fiduciaire, reposant sur la confiance que le monde plaçait en elle et la propulsant au rang de monnaie de référence mondiale, régissant des échanges, des transactions et des décisions politiques.
Sans être identique, le chemin que suit la donnée numérique présente des similitudes intrigantes. Née de la numérisation de nos activités quotidiennes, elle a gagné en valeur à mesure que les entreprises ont appris à l’extraire, à l’analyser et à en tirer profit. Elle est aujourd’hui une ressource convoitée, un levier pour des transactions allant de la publicité ciblée au développement de technologies d’intelligence artificielle. Mais remplit-elle réellement les fonctions fondamentales d’une monnaie ? Répond-elle aux trois caractéristiques qui font qu’un actif est considéré comme une monnaie : servir d’unité de compte, de moyen d’échange et de réserve de valeur ?
En ce qui concerne la notion d’unité de compte, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu’elle est utilisée pour mesurer et quantifier le comportement des utilisateurs, pour évaluer des performances publicitaires ou encore pour segmenter des marchés. Ensuite, la donnée est-elle un moyen d’échange ? Oui. Nos clics, nos recherches et nos interactions sur les plateformes numériques sont une forme de paiement indirect qui nous donne accès à des services financés par l’exploitation commerciale de ces données (pensez à Facebook). Enfin, remplit-elle également la fonction de réserve de valeur ? Oui. Tant qu’elles peuvent être exploitées, les données accumulées gardent leur potentiel économique, générant une richesse latente pour les entreprises qui les détiennent.
Là où le bât blesse, c’est que contrairement au dollar, la donnée souffre d’une absence flagrante de régulation et de gouvernance centralisée. Alors qu’une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine supervise et contrôle la masse monétaire pour stabiliser l’économie, il n’existe pas d’institution équivalente dans l’univers des données.
Pire encore, ce rôle est bien souvent assumé de manière implicite par les géants du numérique, qui agissent comme des dépositaires informels de cette « monnaie numérique », tout en échappant aux obligations de transparence ou de légitimité publique, et laissant les citoyens, les gouvernements et nos sociétés hors de l’équation, pourtant au centre de cette mécanique. Et si, au lieu de céder nos données sans contrepartie réelle, nous reprenions leur contrôle ?
C’est l’idée que certains penseurs et activistes technologiques poussent. Celle d’inverser la dynamique actuelle pour permettre à chacun de monétiser ses propres données ou de percevoir un dividende équivalent à leur exploitation. Imaginez un monde où nous pourrions décider quand, comment et à qui vendre nos données, en fonction de leur valeur ou de leur sensibilité. Un monde où nos clics et nos comportements numériques ne seraient plus simplement capturés et exploités à notre insu, mais où nous aurions un rôle actif dans ce processus. Ce serait un saut équivalent à l’introduction de la monnaie dans les premières économies marchandes. Un bouleversement susceptible de redistribuer la richesse tout en repensant les modes d’interaction économiques.
Si nous acceptons à présent collectivement l’idée que la donnée est un actif de grande valeur, alors la suite logique est qu’elle doit être taxée.
Tout comme les revenus, la consommation ou la propriété sont soumis à l’impôt dans nos systèmes fiscaux actuels, appliquer un schéma similaire à la donnée semble logique. Dans ce scénario, la fiscalité ne se bornerait donc pas comme aujourd’hui à poursuivre les profits comptables ou à tracer la localisation des revenus, un exercice qui est la plupart du temps futile avec les géants numériques.
Elle se focaliserait plutôt sur la ressource même qui constitue le cœur de l’économie numérique. Mais les défis sont nombreux puisque les données diffèrent des monnaies traditionnelles par plusieurs aspects importants. Par exemple, elles sont non exclusives. Cela signifie que différentes entités peuvent exploiter les mêmes données en parallèle sans les « épuiser ». Ensuite, leur valeur est également largement contextuelle. Une donnée brute n’est utile que si elle est analysée, mise en contexte, et exploitée dans un cadre pertinent. Ces caractéristiques spécifiques rendent difficile l’établissement d’une « banque centrale des données » ou d’une autorité équivalente capable de réguler leur production, leur distribution et leur taxation à l’échelle mondiale.
Une chose est cependant certaine. La fiscalité doit évoluer pour s’adapter aux réalités d’une économie qui, elle, ne cesse de changer. La donnée représente une richesse centrale qu’il serait irresponsable d’ignorer. Chaque clic que nous faisons est un fragment de la richesse collective. Repenser la fiscalité à l’ère du numérique n’est pas seulement une question d’équité financière. C’est une nécessité pour préserver la souveraineté des États, garantir la vitalité de nos économies et, surtout, maintenir un pacte social qui, sans cela, risque de s’effriter à mesure que nous avançons dans le monde numérique.