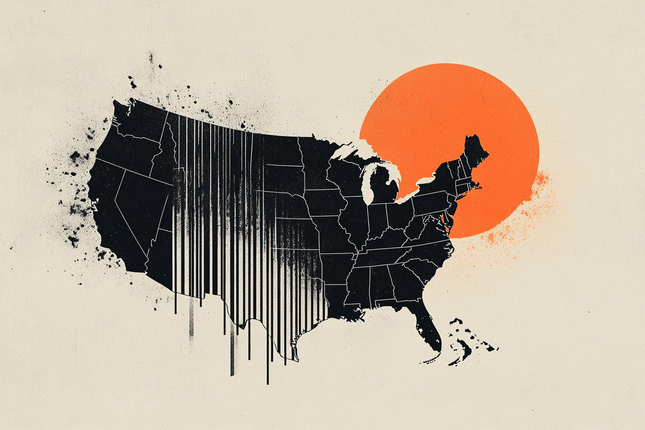Au début, ce n’était qu’un murmure discret dans des sections relativement isolées de la presse financière. Aujourd’hui, cependant, les voix se font plus fortes: le dollar américain pourrait perdre son rôle de monnaie mondiale avec l’effondrement de tous les arrangements et mécanismes de l’après-guerre, sous l’effet de la guerre économique menée par les États-Unis contre le reste du monde par le président Trump.
Cette semaine, le Financial Times (FT) a publié un article majeur intitulé «Le monde perd-il confiance dans le tout-puissant dollar américain?» La réponse est oui.
Cette inquiétude a été suscitée par une évolution inhabituelle sur les marchés financiers. En temps normal, les perturbations financières entraînent une hausse du dollar, les investisseurs recherchant une valeur refuge et se tournant vers les obligations du Trésor américain.
Mais depuis le «jour de la libération», où Trump a dévoilé ses «tarifs réciproques», les investisseurs ont boudé la dette publique du gouvernement des États-Unis, et la valeur du dollar a chuté. Le prix de l’or, véritable réserve de valeur, contrairement à la dette et au crédit, continue d’atteindre des sommets.
Ce revirement a connu un ralentissement lorsque Trump a annoncé une suspension de 90 jours des droits de douane réciproques, qui varient entre 30 et 50 pour cent pour un large éventail de pays, afin de permettre la tenue de négociations. Mais la question demeure: que se passera-t-il après la fin de cette pause?
Quelle que soit la réponse immédiate, une chose est sûre: il n’y aura pas de retour au statu quo, Trump avertissant que personne ne «s’en tirera». Cette semaine, des discussions ont eu lieu entre l’administration et le Japon à Washington. Le représentant japonais au Commerce est rentré bredouille.
Les implications de la nouvelle situation ont été soulignées dans un commentaire d’un éditorialiste de premier plan du FT, Rana Foroohar, intitulé «L’Amérique instable».
Foroohar a commencé par dire que ce qu’elle avait retenu du chaos tarifaire et de ses retombées était que l’Amérique, sous Trump, est devenue un «marché émergent».
Au cours des précédentes périodes de stress politique et économique, les actions et la monnaie américaines ont augmenté en raison du «statut de valeur refuge» du dollar.
«Il ne semblait pas avoir d’importance que tous les atouts qui avaient soutenu les entreprises américaines, des taux bas à l’ingénierie financière en passant par la mondialisation elle-même, aient été épuisés. Les marchés d’actifs américains semblaient insensibles à l’idée d’un scénario apocalyptique du dollar qui ferait chuter la monnaie et les prix des actifs. Trump a enfin mis fin au privilège exorbitant de l’Amérique.»
Elle a conclu en disant qu’auparavant elle aurait exclu la possibilité que l’Amérique puisse devenir l’épicentre d’une crise de la dette de type marché émergent, mais «plus maintenant».
Les mesures de Trump – les hausses de tarifs douaniers qui ralentiront l’économie et les réductions d’impôts proposées pour les entreprises – ajouteront des milliers de milliards de dollars à ce qui est de plus en plus qualifié de montagne de dette «insoutenable», qui s’élève actuellement à 36 000 milliards de dollars et qui continue d’augmenter.
Dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur les changes à la Deutsche Bank, a résumé les perspectives de croissance dans les principaux cercles financiers mondiaux.
«Malgré le revirement du président Trump sur les droits de douane, le dollar américain a déjà été touché», a-t-il écrit dans un rapport. «Le marché réévalue l’attrait structurel du dollar comme monnaie de réserve mondiale et s’engage dans un processus de dédollarisation.»
Cependant, la crise n’est pas seulement le résultat des actions de Trump. Elle se prépare depuis longtemps, résultat d’un déclin prolongé de la situation économique des États-Unis.
Trump, comme cela est désormais ouvertement reconnu, a mis à mal les mécanismes économiques, commerciaux et financiers mis en place après la Seconde Guerre mondiale, considérant qu’ils ont contribué de manière décisive à l’affaiblissement des États-Unis.
Bien sûr, Trump, pour qui, comme Henry Ford, «l’histoire est une baliverne», n’explique jamais pourquoi ces mesures ont été mises en place ni pourquoi les États-Unis ont joué un rôle majeur dans leur mise en place. C’était en grande partie, pour reprendre l’expression qu’il utilise si souvent dans ses diatribes, par souci de «sécurité nationale».
Le but des mesures d’après-guerre était d’empêcher le retour aux conditions qui avaient prévalu dans l’entre-deux-guerres, en partant notamment du principe que cela conduirait à des luttes révolutionnaires de la classe ouvrière dans les principaux pays capitalistes, y compris aux États-Unis, qui avaient connu d’énormes éruptions de luttes de classe dans les dernières années des années 1930.
L’ordre économique d’après-guerre reposait sur trois piliers: l’instauration du dollar américain, adossé à l’or, comme monnaie internationale; la réduction des droits de douane et la promotion du libre-échange pour prévenir l’émergence des guerres commerciales et monétaires qui s’étaient révélées si désastreuses dans les années 1930; et la reconstruction de l’Europe déchirée par la guerre grâce au plan Marshall. Ces trois piliers reposaient sur la force et la puissance industrielle de l’économie américaine.
Contrairement aux affirmations de divers économistes bourgeois et de nombreux marxistes autoproclamés selon lesquelles le boom économique du capitalisme d’après-guerre qui a suivi a réfuté l’analyse marxiste de l’effondrement économique historiquement inévitable du système capitaliste, le cadre d’après-guerre n’a pas surmonté ses contradictions fondamentales – en particulier celle entre le marché mondial et sa division en États-nations rivaux et en grandes puissances.
Et en l’espace de 25 ans – une courte période historique – ces contradictions sont apparues. Le 15 août 1971, face à un déficit croissant de la balance commerciale et de la balance des paiements des États-Unis, le président Nixon a supprimé l’adossement à l’or du dollar américain, abrogeant ainsi unilatéralement les accords de Bretton Woods de 1944.
C’était un signe que le pouvoir du capitalisme américain, fondement de l’ordre d’après-guerre, commençait à s’affaiblir sensiblement.
L’abandon du système de Bretton Woods a inauguré un nouveau système financier mondial. Dans les années 1950 et 1960, les monnaies s’échangeaient à taux fixes. Le maintien de ces taux fixes et la prévention des guerres monétaires exigeaient une réglementation stricte des flux financiers et d’investissement.
Mais avec la fin du lien dollar-or, les monnaies ont commencé à flotter librement, ce qui a nécessité l’abandon progressif des contrôles financiers et des capitaux. Un nouvel ordre économique international s’est développé, fondé sur la création de crédit et la libre circulation de l’argent à travers le monde.
Le dollar américain a continué de servir de base au système financier international, mais il a subi une transformation majeure. Il fut désormais une monnaie fiduciaire, non plus adossée à l’or, c’est-à-dire à la valeur réelle, mais uniquement à l’État américain. Un nouvel ordre monétaire a vu le jour.
Comme le souligne l’article du Financial Times: «Malgré la rupture du lien entre le dollar et l’or par Nixon en 1971, le billet vert est resté au cœur de l’univers monétaire. En réalité, grâce à son importance dans un système financier mondial en expansion et de plus en plus interconnecté, son importance n’a fait que croître. Loin de l’éroder, le choc Nixon l’a au contraire consolidée à bien des égards.»
La libération du dollar des restrictions liées à son rattachement à l’or et les réglementations gouvernementales concomitantes visant à maintenir un système de change fixe ont libéré la finance des contraintes qui lui étaient imposées sous le régime précédent, ouvrant de vastes nouvelles voies d’accumulation de profits.
De plus en plus, surtout dans l’économie américaine, cela a donné lieu à ce qu’on a appelé la financiarisation, l’accumulation de profits par des méthodes spéculatives et parasitaires.
Plus ces méthodes se sont développées, plus les réglementations sur le capital financier introduites en réponse à la crise des années 1930 ont été abandonnées, ce qui a abouti à l’abrogation du dernier texte de loi de l’époque de la Grande Dépression, le Glass-Steagall Act, par l’administration Clinton en 1999.
En 1991, la liquidation de l’Union soviétique par la bureaucratie stalinienne, associée à la restauration du capitalisme en Chine et à l’abandon des politiques de développement national par les régimes nationaux bourgeois des anciennes colonies, a ouvert de nouvelles opportunités de profit grâce à la mondialisation de la production.
Désireux de les saisir, les États-Unis ont appelé à l’entrée de la Chine dans le nouvel ordre mondial. L’administration Clinton a fait pression pour son admission à l’Organisation mondiale du commerce, ratifiée ultérieurement par les États-Unis sous la présidence de George W. Bush.
Les États-Unis considéraient la main-d’œuvre chinoise, moins chère, comme une mine d’or et estimaient que, dans le nouvel ordre, la Chine leur resterait subordonnée. Mais l’économie capitaliste a sa propre logique implacable, qui opère dans le dos des dirigeants impérialistes, aussi puissants soient-ils.
L’oligarchie capitaliste chinoise, désormais confrontée à la transformation du pays d’une nation de paysans en une nation de centaines de millions de travailleurs, ainsi qu’une classe moyenne émergente, a reconnu qu’elle devait progresser dans la chaîne de valeur.
Elle ne pouvait pas simplement fonctionner comme un fournisseur de biens de consommation bon marché, mais devait étendre sa production à des produits plus sophistiqués basés sur une technologie avancée si elle voulait soutenir la croissance économique et maintenir ce qu’elle appelait la «stabilité sociale».
Cependant, cette évolution a posé un défi existentiel à l’hégémonie américaine. L’administration Obama l’a reconnu en 2011, lorsqu’elle a lancé son pivot vers l’Asie. Son représentant au commerce, Michael Froman, a écrit un article dans Foreign Affairs en 2014, reconnaissant l’affaiblissement de la position des États-Unis et la nécessité de «revitaliser» le système commercial mondial pour lui permettre de jouer un rôle moteur.
Ces efforts ont toutefois été vains, la balance commerciale et la balance des paiements continuant de se dégrader. La dette publique américaine a continué de grimper à un rythme reconnu comme «insoutenable».
Les États-Unis n’ont pu poursuivre leur endettement que grâce au rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Tant que les investisseurs, nationaux et internationaux, ainsi que d’autres gouvernements, ont maintenu l’afflux de capitaux sur le marché de la dette, l’État impérialiste américain, avec ses vastes dépenses militaires, a pu continuer à fonctionner.
En 2023, CNN et le commentateur de l’actualité Fareed Zakaria ont exposé cette relation.
«Les politiciens américains se sont habitués à dépenser sans se soucier des déficits – la dette publique a presque quintuplé, passant d’environ 6 500 milliards de dollars il y a 20 ans à 31 500 milliards de dollars aujourd’hui. La Fed a résolu une série de crises financières en multipliant massivement son bilan par douze, passant d’environ 730 milliards de dollars il y a 20 ans à environ 8 700 milliards de dollars aujourd’hui. Tout cela ne fonctionne que grâce au statut unique du dollar. Si ce statut s’affaiblit, l’Amérique sera confrontée à un défi sans précédent.»
Face à cette crise, certains milieux avancent l’idée que, quelles que soient les difficultés du dollar, il continuera à fonctionner comme la monnaie mondiale.
L’article du FT sur la crise du dollar cite les remarques de Mark Sobel, ancien fonctionnaire du Trésor et désormais président américain de l’OMFIF, un groupe de réflexion financier.
«La domination du dollar perdurera dans un avenir proche, car il n’existe aucune alternative viable», a-t-il déclaré. «Je doute que l’Europe puisse se ressaisir, et la Chine n’est pas près d’ouvrir son compte de capital. Alors, quelle est l’alternative? Il n’y en a tout simplement pas.»
Les affirmations de Sobel sur l’incapacité de l’Europe et de la Chine à fournir une alternative au dollar sont sans aucun doute vraies.
Mais son analyse est incomplète car elle repose sur une logique erronée qui ignore les leçons de l’expérience historique. Elle repose sur l’hypothèse selon laquelle, puisque le commerce et la finance mondiaux nécessitent une monnaie internationale, le dollar doit donc continuer à jouer ce rôle, car rien ne peut le remplacer.
Cependant, la logique de la situation actuelle n’est ni que le rôle du dollar puisse perdurer, ni qu’une autre monnaie nationale le remplace. Au contraire, l’économie mondiale se fragmentera de plus en plus en blocs commerciaux, financiers et monétaires rivaux – un conflit de tous contre tous – comme ce fut le cas entre les deux guerres mondiales, avec toutes les conséquences désastreuses que cela a entraînées.
Malgré leur irrationalité et leur folie pure, les politiques de Trump suivent une logique. Chacune de ses déclarations et chacun de ses décrets sont justifiés par la sécurité nationale: l’ordre économique actuel a affaibli la capacité militaire des États-Unis à mener des guerres, et il faut y remédier à tout prix.
La crise du dollar signifie donc que les conditions d’une nouvelle guerre mondiale se développent rapidement, dans laquelle, pour les États-Unis, la Chine – la menace existentielle pour leur hégémonie – constitue la cible principale.
Avec des droits de douane fixés à 145 pour cent, des hausses à venir et des restrictions sur les exportations de biens de haute technologie vers la Chine, les États-Unis ont imposé un quasi-blocus économique à Pékin. Combien de temps faudra-t-il avant que cela ne débouche sur un conflit militaire ouvert? L’histoire suggère que ce sera plutôt tôt que tard.
Les classes dirigeantes, aux États-Unis comme à l’international, n’ont aucune solution à la crise du système capitaliste qu’elles gouvernent. Partout, leur réponse à cet effondrement est la guerre économique, l’augmentation des dépenses militaires et la destruction des droits démocratiques par l’imposition de régimes fascistes et autoritaires.
La classe ouvrière internationale est la seule force sociale capable de résoudre de manière progressiste la crise historique du système capitaliste, illustrée de manière si flagrante par la crise du dollar. Mais pour que ce pouvoir puisse se concrétiser, elle doit s’approprier et défendre la perspective de la révolution socialiste.
[Article paru en anglais le 19 avril 2025]